Nous sommes de plus en plus nombreux à aimer la Corée du Sud pour sa culture. Musicale d’abord mais aussi cinématographique, culinaire, touristique… Mais qu’en est-il de son Histoire ? Combien d’entre vous connaissent réellement les éléments passés qui font du Pays du Matin Calme ce qu’il est aujourd’hui ? Pas de panique ! Nous sommes là pour y remédier. Installez-vous confortablement et dégustez ce premier volet d’une petite mise au point…

La Corée est née d’une légende racontant qu’en 2333 avant notre ère, l’Empereur céleste envoie son fils, Hwanung, sur terre afin d’enseigner aux hommes les rudiments des lois, de l’agriculture et de la médecine. Établi dans la chaîne des monts Taebaek, il reçoit la visite d’une ourse et d’une tigresse souhaitant prendre forme humaine. Pour ce faire, les deux animaux doivent réussir une épreuve, à savoir rester au fond d’une caverne, dans l’obscurité, pendant cent jours, avec pour seule nourriture quelques gousses d’ail et un paquet d’armoise, nourriture sacrée. Lasse de la difficulté, la tigresse abandonne au bout d’un mois tandis que l’ourse résiste et parvient au terme de l’épreuve. Elle est alors transformée en femme avec laquelle Hwanung se marie. De cette union naît un fils, Tangun, le fondateur du premier royaume de Gojoseon dit le pays du « matin clair et frais » ; pays dont le nom sera traduit au XIXe siècle par Percival Lowell en « pays du matin calme ». La Corée (non-divisée) est née.
Objet de convoitise pour les grandes puissances qui l’entourent, scindée en deux parties à la fin des années 1940, les matins ne sont plus si calmes en Corée depuis de nombreuses années. On constate par ailleurs que l’histoire de la péninsule coréenne est jonchée de conflits, le plus marquant étant sans aucun doute celui dont résulteront les deux Corée que nous connaissons.
Nous nous excusons d’avance pour le ton un peu scolaire que va prendre cet article mais il est indispensable pour comprendre tout ce qui suivra.

Le 15 août 1945, après une annexion du Japon de trente-cinq ans, la Corée retrouve son indépendance. Cette date, d’ailleurs, restera dans les annales historiques des deux États mais sous différents noms. En effet, elle sera nommée « Journée du retour à la lumière » au Sud et « Jour de la libération de la Patrie » au Nord.
De manière à désarmer les troupes japonaises, la péninsule est divisée en deux États dits « provisoires » à la hauteur du 38e parallèle – point géographique utilisé comme démarcation de division entre les deux États politiquement opposés, à savoir les puissances politiques américaine et soviétique. Au Nord de cette démarcation, les Soviétiques obtiennent l’abandon des troupes japonaises et assurent leur désarmement. Au Sud, les Américains procèdent de la même façon. Cette occupation du territoire (ainsi que sa division) par les deux puissances émergentes de la Seconde Guerre Mondiale est censée être temporaire. Mais la poursuite de la Guerre Froide entre les deux camps, l’un communiste et l’autre libéral – devinez qui est qui -, conduit indubitablement à la séparation définitive de la Corée en deux États profondément opposés en 1948.
La « République de Corée », sous domination américaine, naît ainsi au Sud avec pour président Syngman Rhee tandis que la « République populaire démocratique de Corée », sous domination pro-soviétique, se développe au Nord dirigée par Kim Il Sung (ce cher Kim Il Sung !).

En 1949, les troupes américaines et soviétiques se retirent de la péninsule coréenne. Cette même année, les tensions entre la Corée du Nord et la Corée du Sud deviennent régulières avec, tous les mois, des incidents enregistrés le long du 38e parallèle. On peut citer par exemple l’attaque des troupes sud-coréennes de la ville de Kaesong le 4 mai 1949, attaque d’une durée de quatre jours qui fera des centaines de morts de part et d’autre. Mais ces nombreux conflits n’inquiètent pas la communauté internationale, ce qui n’est pas le cas du président sud-coréen.
En 1950, Syngman Rhee déclare à l’ambassadeur américain que les Sud-Coréens sont « prêts à combattre jusqu’à la mort » et alerte que « les mouvements de troupes nord-coréens ne sont pas habituels [et qu’]une attaque est possible ». Le général MacArthur déclare au mois de mai 1950 qu’il ne croit pas à une guerre ouverte. Et pourtant…

Le 25 juin 1950, à 4 heures du matin, les troupes nord-coréennes ouvrent le feu en franchissant le 38e parallèle. Trois jours plus tard, Séoul tombe entre les mains de la Corée du Nord. La guerre de Corée commence.
Le 27 juin, le Conseil de sécurité de l’ONU déclare, en l’absence de l’URSS, que la Corée du Nord est l’agresseur et qu’il convient de soutenir la Corée du Sud. Les Nations Unies font appel au général MacArthur afin de diriger les troupes américaines, envoyées en soutien. Les troupes alliées reconquièrent Séoul le 28 septembre 1950 et progressent vers le Nord afin d’atteindre le Yalou – fleuve matérialisant la démarcation entre la République populaire de Chine et la Corée du Nord – en octobre. Alors que la victoire paraît acquise, la Chine prend position pour Pyongyang (capitale de la Corée du Nord) et entre dans le conflit entre octobre et novembre. Cette offensive chinoise contraint les forces internationales à quitter Séoul (en janvier 1951) et reculer à 100 kilomètres du 38e parallèle. Toujours en 1951, l’offensive chinoise s’arrête, permettant aux troupes internationales de reprendre Séoul (en mars) et d’atteindre de nouveau le 38e parallèle, en progressant toujours plus vers le nord.
C’est à cette période que Jakob Malik (le représentant soviétique à l’ONU) propose de réfléchir à un possible armistice. Des discussions s’engagent en parallèle des combats.

L’armistice est finalement signé le 27 juillet 1953, sans qu’il y ait pour autant un traité de paix. Aucune des deux parties n’obtient de gains territoriaux, les morts et les décès dépassent le million et l’économie est ruinée. De plus, l’armistice instaure une zone démilitarisée (aussi nommée DMZ), le long du 38e parallèle. Ce texte fixe également la Ligne de Limite Nord (aussi appelée NLL) qui se situe dans la mer Jaune. Cette démarcation n’est pas reconnue comme frontière par Pyongyang puisqu’elle a été instaurée par les Nations Unies. Cela va conduire à de violents accrochages en 1999, 2002 et 2009. La DMZ existe toujours et fonctionne comme une véritable frontière hermétique, séparant deux frères ennemis qui ne vont cesser de se quereller au cours des années suivantes.
En 1968, des commandos des forces spéciales nord-coréennes lancent des raids contre la résidence présidentielle de Séoul. Quatre ans plus tard, un espoir de paix germe. Un dialogue secret s’engage entre les deux pays afin d’aboutir à la réunification. Cet espoir est vite piétiné puisque le dialogue entre les deux pays est suspendu un an plus tard.
En 1983, on attribue au régime de Pyongyang l’attentat contre le président sud-coréen Chun Doo Hwan en Birmanie. Quatre ans plus tard, un nouvel attentat est attribué à deux agents nord-coréens, celui contre un Boeing de la Korean Airlines qui fera cent quinze morts. Un an plus tard, la Corée du Nord refuse de participer aux Jeux Olympiques organisés à Séoul.

Événement historique : le 8 juillet 1994, Kim Il Sung décède. Son fils Kim Jong Il prend alors le pouvoir. Deux ans après, Pyongyang remet en cause l’armistice de 1953 et s’en détache en envoyant des troupes dans la DMZ. Vingt-quatre agents nord-coréens et quatre sud-coréens sont tués lors de la tentative d’infiltration d’un sous-marin de poche en Corée du Sud.
L’année 1999 voit naître le premier affrontement entre les deux pays dans la mer Jaune (mer séparant la Chine de la péninsule coréenne). Cet affrontement porte sur l’accès à la zone de pêche en périphérie de l’île de Yeonpyeong, théoriquement réservée aux bateaux sud-coréens. L’affrontement fera environ une trentaine de victimes.
Le rapprochement « Sunshine Policy » va de nouveau faire germer l’espoir d’une réconciliation entre les deux opposants puisqu’en 1998, le président sud-coréen Kim Dae Jung cherche à mettre en place une politique de rapprochement avec le Nord. Il rencontre son homologue Kim Jong Il et met en place une assistance économique pour le Nord.
En 2000, l’ouverture de bureaux de liaison dans le village frontalier de Panmunjeom (village aujourd’hui disparu) permet à des centaines de familles qui ont été séparées de se rencontrer. Mais ce rapprochement sera de courte durée.

En 2002, le président américain Georges W. Bush inclut la Corée du Nord dans son discours sur « l’Axe du Mal » (cet « axe » désigne différents pays comme voulant se procurer des armes de destruction massive et soutenant le terrorisme ; bien que cette conception soit tout à fait discutable, il existe par exemple un trafic d’armes entre la Corée du Nord et l’Iran). La même année, on assiste à un nouvel affrontement en mer Jaune faisant une quarantaine de victimes des deux côtés, toujours pour un différend concernant la pêche. C’est également le début d’opérations de déminage dans la zone frontalière et la reprise du programme nucléaire de la Corée du Nord en décembre.
L’année 2003 voit le lancement en Juin de la zone économique spéciale intercoréenne de Kaesong (zone qui veut accueillir d’ici 2020 environ 2 000 entreprises et employer 500 000 Nord-Coréens). La même année, Pyongyang se retire du Traité de non-prolifération nucléaire. Ce retrait amène en août la première réunion sur la dénucléarisation de la Corée du Nord, en présence des deux Corée, des États-Unis, de la Chine, du Japon et de la Russie (réunion que l’on appelle également « négociations à six »).
Trois ans plus tard, le 9 octobre 2006, la Corée du Nord annonce avoir réussi son premier essai nucléaire. L’année suivante, elle accepte de désactiver son programme nucléaire, en échange de la fourniture d’énergie et de garanties de sécurité de la part des États-Unis. En mai, deux convois ferroviaires franchissent pour la première fois la zone de démarcation Nord/Sud depuis la fin de la guerre. En octobre se tient le deuxième sommet intercoréen et permet la signature d’une déclaration de paix.

L’année 2008 signe le retour de nouvelles tensions dans la péninsule coréenne. En effet, cette année-là, le président conservateur sud-coréen Lee Myung Bak met fin à la politique conciliante avec la Corée du Nord (politique dénoncée par ailleurs par Pyongyang). Entre mars et avril, Pyongyang expulse des cadres de la zone économique mixte. En juillet, des gardes du site touristique du mont Kumgang (une des rares enclaves nord-coréennes ouvertes à la Corée du Sud) abattent une touriste qu’ils pensaient être une espionne. En novembre, la Corée du Nord annonce la fermeture de ses liaisons ferroviaires, du parc industriel de Kaesong ainsi que du complexe touristique du mont Kumgang.
En 2009, la Corée du Nord met fin à tous les accords passés avec la Corée du Sud, y compris le pacte de non-agression. En mai, la Corée du Nord annonce avoir réussi son second essai nucléaire souterrain. Le même mois, la Corée du Sud annonce devenir membre à part entière de l’initiative de Sécurité contre la prolifération qui autorise l’arraisonnement en haute mer de navires suspectés de transporter des armes de destruction massive. En juin, l’espoir renaît de nouveau. En effet, les discussions intercoréennes reprennent et la Corée du Nord accepte la reprise des voyages avec son voisin du Sud.
En 2010, Pyongyang appelle à la fin des hostilités avec les États-Unis, afin d’assurer la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne. C’est une accalmie de courte durée puisqu’en janvier 2010 se produit un échange de tirs entre les deux Corée, près de la frontière très contestée en mer Jaune. En mars, Séoul soupçonne Pyongyang d’avoir torpillé Cheonan (ville sud-coréenne) près de cette même frontière et d’avoir ainsi causé la mort de quarante-six marins (une commission d’enquête internationale validera par ailleurs ces soupçons). La Corée du Sud demande alors au Conseil de sécurité des sanctions à l’égard de la Corée du Nord pour cet accident et, en représailles, Pyongyang rompt tout contact avec le Sud. En juin, la Corée du Nord annonce avoir l’intention de renforcer son arsenal nucléaire en réponse à l’hostilité (et aux menaces militaires) américaine. En juillet, l’ONU condamne le torpillage de Cheonan, sans pour autant l’amputer clairement à la Corée du Nord (qui est toujours sous la protection de la Chine). En juillet, lors d’un voyage en Corée du Sud, Hillary Clinton annonce la prise de sanctions contre les entreprises de Corée du Nord. Pyongyang brandit alors la menace d’une guerre nucléaire. Et de nouveau, l’espoir d’une réconciliation jaillit. En août, le Nord annonce à Jimmy Carter sa volonté de reprendre les négociations lancées en 2003. En septembre, il propose des pourparlers militaires avec le Sud, notamment concernant la frontière maritime dans la mer Jaune. En octobre, pour la première fois depuis l’ascension au pouvoir de Lee Myung Bak, Séoul accepte d’envoyer de l’aide alimentaire au Nord qui traverse une période de famine. Mais le 20 novembre, Pyongyang dévoile une usine d’enrichissement d’uranium. Trois jours plus tard, la Corée du Nord tire plus d’une centaine d’obus et de roquettes sur l’île de Yeonpyeong (île située en Corée du Sud, qui vient tout juste d’accueillir le G20) en mer Jaune. Cet incident fait quatre victimes et quatorze blessés. Il déclenche par ailleurs une riposte armée de la part de Séoul. On peut remarquer que cette démonstration de force coïncide avec la désignation de Kim Jong Un comme héritier.
En 2011, à New York, ont lieu des entretiens entre responsables américains et nord-coréens. Kim Jong Il se déclare prêt à imposer un moratoire sur les essais nucléaires à condition de reprendre les pourparlers. En octobre, Pyongyang procède aux tirs d’essai de nouveaux missiles antinavires en mer Jaune, ce qui a pour effet de renforcer les défenses aériennes sud-coréennes. Pyongyang hausse le ton. Le 17 décembre, Kim Jong Il décède. On assiste à un nouveau tir de missile deux jours plus tard.
La Corée a donc connu de nombreux affrontements, parfois très violents, qui ne sont pas sans conséquences sur les deux pays. Restez avec nous pour en connaître la nature autant au Nord qu’au Sud…
Sources :
Les Coréens, Pascal Dayez-Burgeon, 208 pages, p11 à 28, Edition Tallandier, 2011/2013
La Corée, Claude Balaize, Li Jin-Mieung, Li Ogg et Marc Orange, 125 pages, Presses Universitaires de France, 1991
La Guerre de Corée 1950-1953, Ivan Cadeau, 367 pages, Editions Perrin
fr.wikipedia.org/ | www.monde-diplomatique.fr/ |blog.mondediplo.net/ | www.lexpress.fr/ | www.lemonde.fr/


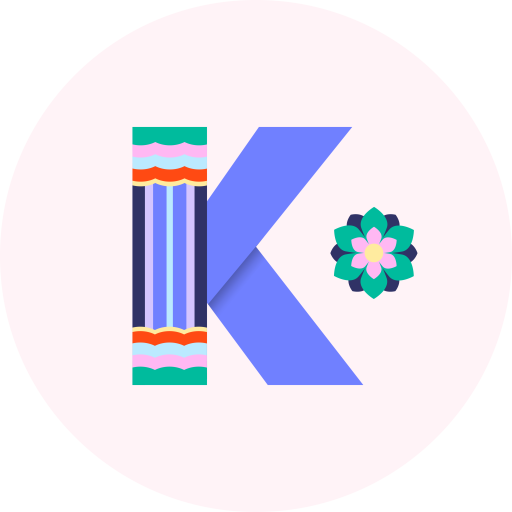




![[MàJ] Epik High : un neuvième album à douze voix Epik High we've done something wonderful](https://koreasowls.fr/wp-content/uploads/2017/10/Epik-High-weve-done-somehting-wonderful-K.owls_.jpg)

![Les sorties K-hip hop [18/02/2018] (Changstarr, YunB, Mighty Mouth…) Changstarr - Sorties KHH-18022018](https://koreasowls.fr/wp-content/uploads/2018/02/Sorties-KHH-1.png)