On le sait, les Coréens sont un peuple qui, tout au long de son histoire, a dû lutter pour son pays, que ce soit pour résister aux invasions ou ne pas se soumettre à la colonisation. Aujourd’hui encore, cela ne fait pas exception. Seulement, les combats se tiennent au sein même du pays, afin de revendiquer leurs droits et leurs libertés individuelles.
NB : Chacune de ces manifestations est reliée au gouvernement d’un président. Aussi, si vous n’êtes pas familiers de la politique coréenne et de la chronologie concernant les présidents sud-coréens, je vous conseille vivement d’aller parcourir mes trois articles à ce sujet, dont voici la partie I.
La révolution d’avril (1960)

La révolution d’avril, appelée « révolution du 19 avril » en coréen (4.19 혁명), est un soulèvement populaire, estudiantin et ouvrier notamment, qui a duré du 11 au 26 avril 1960. Cependant, des manifestations avaient déjà débuté le 15 mars pour protester contre les élections présidentielles et le régime autoritaire et corrompu de Rhee Syngman. Lors de ces manifestations, des altercations ont lieu entre les forces armées et les citoyens, et un étudiant est tué. Son corps est retrouvé le 11 avril dans le port de Masan, et cette découverte est le point de départ de ce soulèvement. Dès lors, des protestations massives éclatent et le 19 avril une manifestation nationale débute à l’Université de Corée, poussant finalement le président Rhee à démissionner le 26 avril et à s’exiler hors de Corée. Cent quatre-vingt-six personnes auront perdu la vie lors de ces deux semaines d’affrontements entre manifestants et forces armées et des milliers d’autres ont été blessées.
C’est ainsi qu’est renversée la première République de la Corée du Sud. Cette révolution d’avril fait état de prémices aux mouvements de démocratisation des citoyens coréens.
Sources : Yonhap News | Korea.net
Le soulèvement de BuMa (1979)
Le soulèvement de BuMa (부마민주항쟁) a lieu du 16 au 20 octobre 1979 à Busan et Masan (d’où « Bu-Ma »). L’enjeu de ce mouvement était d’abolir le régime dictatorial de Park Chung Hee, nommé Yusin. Ce sont des étudiants qui commencent les protestations à l’Université de Busan avant que des citoyens ne les rejoignent. Finalement, le mouvement prend de l’ampleur et les manifestations s’étendent jusqu’à Masan. Le soulèvement prend fin le 26 octobre, jour de l’assassinat de Park Chung Hee.
Ce mouvement démocratique est bien moins connu que les autres présentés ici. Ce n’est qu’en 2019 que le 16 octobre a été établi comme une journée nationale de commémoration par le président Moon Jae In, permettant ainsi de commencer à éclairer les recherches sur les circonstances et les conséquences de ce mouvement.
Sources : KBS | KoreaScience
Le soulèvement de Gwangju (1980)

Aussi appelé « soulèvement du 18 mai », « massacre de Gwangju » ou encore « 5 1 8 » en coréen (오일팔) (faisant référence au 18 mai), le tristement célèbre soulèvement de Gwangju s’est étendu du 18 au 27 mai 1980.
Tout commence le 17 mai, lorsque Chun Doo Hwan, nommé chef de la KCIA au mois d’avril (rappelons qu’il a pris le pouvoir par un coup d’État et contraint donc le président Choi Kyu Ha de démissionner par la suite), fait proclamer la loi martiale dans tout le pays. Le lendemain, des civils descendent dans la rue, notamment de nombreux étudiants, et manifestent pour protester en faveur de leurs libertés. Cependant, les militaires répliquent immédiatement et commencent alors les émeutes et la répression. Dix jours durant, le gouvernement de Chun Doo Hwan fera ouvrir le feu sur les manifestants, tuant une centaine de personnes et en blessant des milliers. La ville est barricadée par l’armée et personne ne peut sortir de Gwangju, les informations ne circulent donc pas dans le reste du pays. Dans les journaux, commandés par le gouvernement, il est écrit que ce dernier lutte contre une attaque de communistes, perpétrée par des espions venus de Corée du Nord.
Des années durant, les Coréens ont ainsi cru en cette histoire car les preuves furent dissimulées et modifiées. Dans la mémoire collective, les manifestants de Gwangju étaient donc des « rouges ». Ce n’est que des années plus tard que la vérité commence à faire surface.
Dans les années 90 notamment, des étudiants ont à nouveau manifesté pour faire connaître la vérité sur ce massacre et l’implication du gouvernement. Le roman graphique Ma vie en prison de Kim Hong Mo fait mention de ces évènements à travers le récit d’un personnage qui a été envoyé en maison d’arrêt pendant 8 mois à la suite de son implication dans ces mouvements pour rétablir la vérité.
Une autre œuvre très intéressante, directement portée sur les évènements à Gwangju, est le film Taxi Driver, sorti en 2017. Il met en lumière les émeutes de de la ville et l’implication de Jürgen Hinzpeter, un journaliste allemand qui a réussi à se dissimuler dans la ville pour couvrir le massacre.
Sources : Le Point | Revue française d’histoire des idées politiques
Le mouvement démocratique de juin (1987)

Le mouvement démocratique de juin (6월 민주항쟁) est un ensemble de manifestations massives qui ont eu lieu dans tout le pays entre le 10 et le 29 juin 1987.
Sous la présidence de Chun Doo Hwan, l’opposition revendique une révision de la constitution afin d’organiser des élections présidentielles directes. (Rappelons que depuis l’instauration de la Constitution Yusin en 1972 par le président Park Chung Hee, le chef d’État est élu par un collège électoral.) Cependant, Chun balaie les pourparlers d’un revers de la main et annonce, le 10 juin, son intention de faire de Roh Tae Woo le nouveau président. Des manifestations avaient déjà lieu dans le pays, mais à cette annonce, le peuple s’insurge et le mouvement prend plus d’ampleur, tout comme la répression policière. Face à la pression accrue de ces mobilisations et à la proche tenue des Jeux Olympiques à Séoul qui se dérouleront l’année suivante en 1988, Chun doit faire un choix pour calmer la population et décide de la jouer fair-play. Confiant en la victoire de son candidat puisque l’opposition est divisée entre Kim Dae Jung et Kim Young Sam (tous deux présidents par la suite), il accepte la majorité des revendications du peuple, dont celle d’élire le président par suffrage universel mais également de restaurer les libertés civiles. De nombreux prisonniers politiques sont ainsi relâchés au début du mois de juillet.
Bien que Roh Tae Woo soit élu à la tête du pays, pour la Corée cette victoire est une révolution démocratique. Le pouvoir a enfin été mis entre les mains d’un homme par le peuple et non saisi par la force lors d’un coup d’État.
Sources : Universalis | DBPedia
La révolution des bougies (2016-2017)

Bien plus récemment, de très grosses manifestations ont eu lieu en Corée. Certains d’entre vous en ont certainement suivi les faits. La révolution des bougies (촛불집회) a eu lieu pendant 6 mois, d’octobre 2016 à mars 2017.
En 2016, un scandale éclate sur la présidente en place, Park Geun Hye : elle est accusée de corruption et d’abus de pouvoir avec sa confidente de l’ombre, Choi Soon Sil, obligeant notamment de nombreuses entreprises à verser de l’argent dans des fondations dirigées par son amie.
Pour le peuple coréen, il y en a assez de toute cette corruption politique et les citoyens descendent donc une nouvelle fois dans la rue. Chaque semaine, de plus en plus de manifestants se rassemblent, bougies à la main, faisant de cette révolution l’une des plus grosses manifestations du pays. Tous les samedi pendant 6 mois, les Coréens, de toutes tranches d’âge et toutes catégories sociales, descendent dans la rue pour clamer la destitution de la présidente conservatrice (qui est d’ailleurs la fille de Park Chung Hee, contre qui s’est créé le soulèvement de BuMa). Ce sera à nouveau une réussite pour le peuple puisque Park Geun Hye est destituée en mars 2017 et que des élections anticipées sont organisées le mois suivant.
L’un des points très marquants de ces manifestations est qu’elles se sont déroulées sans aucune violence. Contrairement aux autres évènements décrits plus haut, il n’y pas eu d’altercations avec les forces armées. La révolution des bougies est donc une résistance entièrement pacifique, chose qui est assez rare de nos jours, d’autant plus au vu de l’ampleur qu’a prise le soulèvement.
Sources : Revue Sociétés | East Asia Forum
Conclusion
Le peuple coréen a mené de nombreuses luttes contre le gouvernement afin de parvenir à une République démocratique. Les affrontements n’auront pas été faciles mais l’acharnement de la population durant ces dernières décennies n’aura pas été vain. Aujourd’hui encore, avec les récents évènements de 2016-2017, les Coréens ont prouvé qu’ils pouvaient faire entendre leur voix et que la corruption politique n’avait pas sa place dans leur gouvernement.
Photo de une : HanCinema


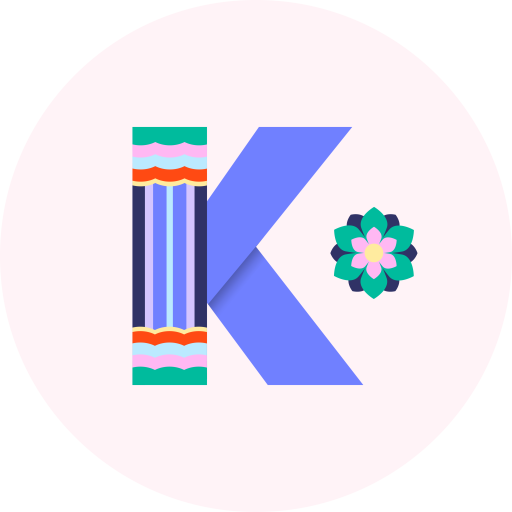





![[Live Report] Concert de l’amitié franco-coréenne [Live Report] Concert de l amitié franco-coréenne](https://koreasowls.fr/wp-content/uploads/2018/10/20181014_155937.jpg)